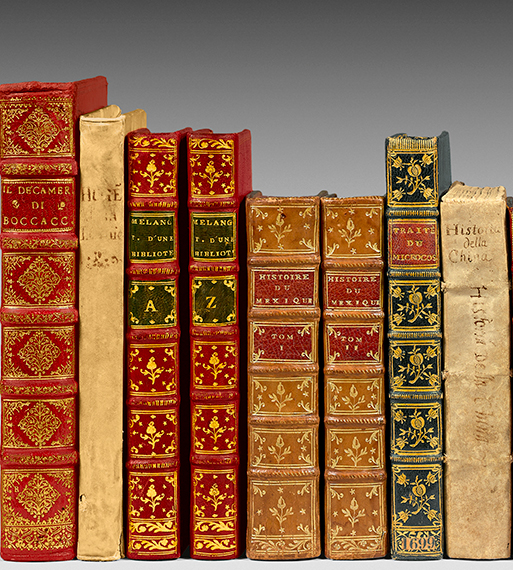Edition originale de ce précieux recueil de modèles d’orfèvrerie gravé en 1748.
Provenances : Émile Froment Meurice (1856) ;
Archibald Philippe Primrose, 5ème Comte de Rosebury.
Paris, 1748.
Germain, Pierre (1703-1783). Éléments d’orfèvrerie divisés en deux Parties de Cinquante Feuilles chacune, composés par Pierre Germain, Marchand Orfèvre Joaillier. Première [-Seconde] partie.
Paris, chez l’auteur et chez la Veuve de F. Cherau, 1748.
2 parties en 1 vol. in-4 de 2 titres gravés, 3 ff. (Dédicace, Avis, table) et 100 planches d’orfèvrerie gravées. Maroquin vert, double encadrement de filets dorés pleins et aux pointillés sur les plats, larges écoinçons d’angles à la grenade et au chérubin, dos à nerfs orné à la grenade, double filet or sur les coupes, large roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Trautz-Bauzonnet vers 1855.
273 x 203 mm.
Édition originale de ce précieux recueil de modèles d’orfèvrerie.
La publication de recueils d’orfèvrerie est un procédé rare. Les orfèvres sont en général jaloux de leurs modèles. Une étude spécifique détaille les motifs possibles de ce parti original pris par le célèbre maître orfèvre Pierre Germain, motifs financiers, besoin de reconnaissance, et avant tout souci pédagogique : « Je n’ay eu d’autre but en composant cet ouvrage, dit-il dans son Avis au lecteur, que d’engager la jeunesse à se former des principes sur les différents genres d’orfèvrerie et sur la diversité des contours » et « faciliter aux élèves les moyens de réussir ».
La plupart des compositions sont signées par Germain lui-même, quelques-unes par son confrère Jean-Jacques Roëttiers et d’autres par Baquoy.
Cohen-de Ricci 429-430 (« Précieux recueil qui contient les plus beaux modèles de l’argenterie parisienne du temps de Louis XV ») ; Bapst. Études sur l’orfèvrerie française au XVIIIe siècle ; les Germain, orfèvres-sculpteurs du Roy, pp. 182 sqq. (« on le considère encore aujourd’hui comme l’ouvrage le plus sérieux de cette sorte »).
En novembre 1747 est annoncée dans le Mercure de France la publication de ses Éléments d’orfèvrerie, recueil de 100 planches de modèles d’orfèvrerie religieuse et civile, gravées au burin par Jean-Jacques Pasquier et Baquoy.
L’orfèvre présente les deux parties de son ouvrage à la Librairie le 26 juin 1748 et reçoit le privilège royal le 16 juillet, alors que la première partie du recueil se vend déjà ou est sous presse. Pierre Germain ajoute à la main le privilège sur les volumes déjà imprimés, l’authentifiant de sa signature. Le second recueil, le Livre d’ornements, paraît en 1751.
Les volumes sont vendus successivement par Nicolas Bonnart, par la veuve de François II Cherau, Geneviève Marguerite, active de 1755 à 1768, puis par son fils Jacques François (1742-1794), enfin par Etienne François Joubert, qui achète à ce dernier les cuivres des deux recueils. On trouve aussi des exemplaires en vente, de 1773 à l’an X, chez le sieur puis citoyen Watin. L’ouvrage vieillissant, son prix baisse de moitié entre 1748 et 1778. Il est acheté par des orfèvres (Benjamin Febvrier, orfèvre à Landernau) et des collectionneurs comme Caze de la Bove, Simon-Judes-François Délézenne, le surintendant des bâtiments Marigny ou le marquis de Paulmy.
Les sources d’inspiration de cette œuvre très construite semblent trahir quelques proximités avec des œuvres de Jacques Roëttiers, mais trop peu d’objets subsistent pour l’affirmer de manière certaine. L’influence postérieure du recueil est en revanche plus visible. Celui-ci est imité en province, par exemple par Frédéric Ier Nesme en 1756 à Lyon et par Joseph Opinel en 1759 à Dole. Il remporte aussi un certain succès à l’étranger, particulièrement en Angleterre, à Londres, où il est largement plagié, imité ou adapté par Thomas Heming, Parker et Wakelin, ou en Italie, où il influence peut-être Andréa Boucheron à Turin. Il reste une source d’inspiration majeure jusqu’à la fin du xixème siècle, particulièrement dans les maisons Aucoc et Cardeilhac. En gravure, il est largement repris dans les planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert entre 1751 et 1772.
Ce beau recueil d’orfèvrerie présente maintes pièces de forme, finement dessinées et gravées : « Contours de plats, pots à sucre, salières, moutardiers, sucriers, flambeaux, seaux à rafraîchir, pots à ailles, surtouts, terrines, cabaret, boîte à poudre et à mouches, coffre à bijoux, pot à eau, miroir… etc. »
« Toutes ces pièces sont charmantes de composition et très utiles à consulter par les orfèvres. » Guilmard, Les Maîtres ornemanistes, 175, n° 50.
Il fut utilisé par la Maison Boin-Taburet comme source d’inspiration dans la création de ses modèles.
Le recueil est dédié à Monseigneur de Machault, contrôleur général des Finances, dont les armes sont gravées en tête de la dédicace.
Superbe exemplaire de ce recueil gravé, évocateur du génie artistique des grands orfèvres parisiens sous le règne de louis XV, et revêtu d’une fine reliure en maroquin de Trautz-Bauzonnet.
Provenances : Émile Froment-Meurice, 1856 ; Archibald Philip Primrose (1847-1928), 5ème Comte de Rosebury avec son ex-libris à ses armes et à la devise de l’ordre de la Jarretière « Honi soit qui mal y pense ».
Emile Froment-Meurice était un orfèvre fournisseur officiel de la ville de Paris, comme son père François-Désirée Froment-Meurice, pour lequel Victor Hugo laissa quelques vers témoignant de la beauté de son art (Les Contemplations, 1856). Reprenant l’atelier de son père, Emile Froment-Meurice œuvra également pour Napoléon III et le duc d’Aumale pour lequel il réalisa la reliure du Bréviaire de Jeanne d’Evreux (actuellement au château de Chantilly).